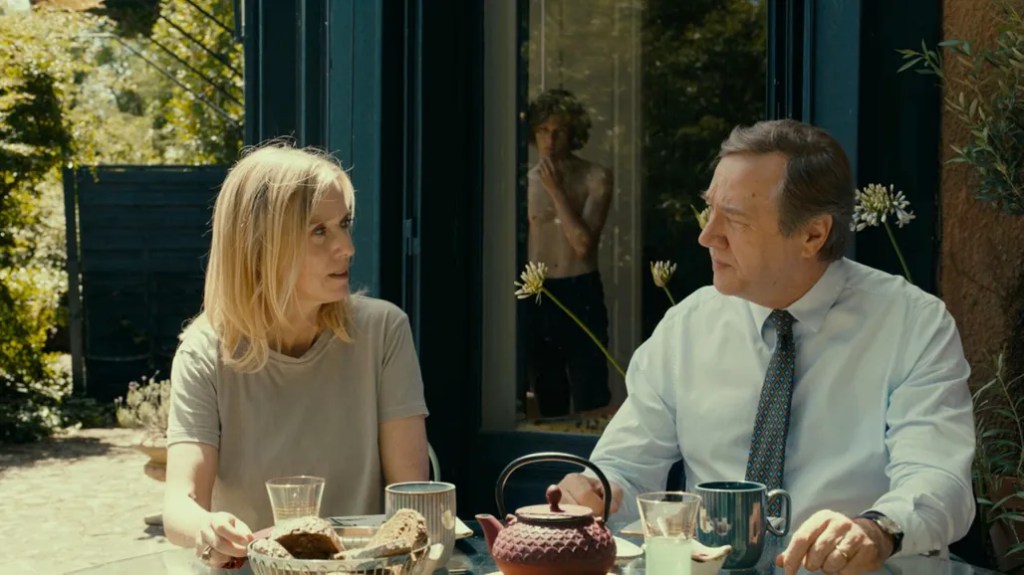L’Enlèvement de Marco Bellocchio évoque l’affaire Edgardo Mortara, du nom de cet enfant juif de six ans, enlevé à sa famille en 1858 par l’inquisiteur de Bologne, la Romagne étant alors Etat-pontifical, et confié à la Maison des Catéchumènes de Rome pour en faire un prêtre. La cause de cet abus de pouvoir du Pape Pie IX, oncle de l’inquisiteur ? Une servante aurait, selon ses dires, secrètement baptisé l’enfant à six mois alors qu’il était malade, de crainte qu’il ne soit condamné aux limbes. Cette conversion forcée fit scandale dans toute l’Europe, et les alliés du Pape, en premier lieu Napoléon III, firent pression pour que l’enfant soit rendu à sa famille, en pure perte, car le pouvoir finissant du Pape tenait à faire d’Edgardo un symbole de la force de l’Esprit saint, le dogme l’emportant sur toute autre considération. En réalité, le véritable scandale était que les conversions forcées, et autres crimes commis contre les Juifs pendant des siècles, avaient été tolérés et même encouragés par la chrétienté, sans que personne ne réagisse jusque là, tant l’antisémitisme était ancré dans les mentalités. La Maison des Catéchumènes à Rome avait précisément était fondée au XVIe siècle pour cela : assurer la conversion d’enfants juifs – mais aussi musulmans.
Bellocchio filme cette histoire comme une tragédie, avec une belle photographie d’intérieur, aux contours clairs obscurs, un ton parfois baroque, où la grandeur de la pompe liturgique et du décorum des églises et des palais romains se mêle au grotesque de certains épisodes impliquant le Pape et au caractère précipité de certains plans, mélange baroque typiquement italien (et en même temps pas du tout viscontien), et une musique appuyant ses effets. Cette tragédie est du reste construite selon une structure musicale, en autant d’actes qu’il faut pour mener le récit jusqu’à son terme, qui est double : d’une part, la chute de l’Etat pontifical romain en 1870, au moment de l’unification italienne, chute qui entraine la perte du pouvoir temporel du Pape ; d’autre part, la vie d’adulte d’un Edgardo devenu prêtre, ayant irrémédiablement renié sa culture juive, au point de vouloir convertir, à son tour, sa propre mère sur son lit de mort. L’intérêt de Bellocchio pour l’Histoire de l’Italie n’est plus à démontrer, son oeuvre se mouvant entre deux pôles, le pôle historique et le pôle familial. Mais l’ambition historique présidant au film finit par entraver son efficacité narrative et son pouvoir de suggestion. Si sa première partie, lorsqu’Edgardo est encore enfant, est remarquable par sa capacité à intégrer le drame familial d’une famille juive ayant perdu l’un des siens au sein de la grande Histoire, et bouleverse quand les parents d’Edgardo soulèvent en vain ciel et terre pour retrouver l’enfant, la deuxième partie, lorsqu’Edgardo est devenu adulte, est encombré d’un certain désordre narratif où les évènements historiques s’enchainent à coup d’ellipses temporelles, sans que le cinéaste parvienne alors à donner suffisamment de chair aux épisodes et au personnage d’Edgardo adulte.
Donner chair à Edgardo, c’est pourtant la raison d’être du film, où Bellocchio s’interroge sur le mystère suivant : comment un enfant juif enlevé de force aux siens a-t-il pu accepter sans régimber outre mesure de devenir catholique ? Comme il l’a fait dans plusieurs films, Bellocchio met en lumière le mécanisme d’acculturation par lequel la société, les institutions, transforment les individus jusqu’à en faire des personnes que les membres de leur propre famille ne peuvent plus reconnaitre. En 2021, il raconta ainsi dans un documentaire, l’histoire tragique de son frère jumeau, devenu farouche marxiste, ayant épousé un dogme vorace et concurrent qui l’a enlevé aux siens. Dans l’enlèvement, Bellocchio filme avec des montages parallèles insistants la lutte de liturgies concurrentes : d’un côté, la prière du Chema Israël (qui a le caractère d’une fidélité familiale, d’une promesse faite à la mère), la mezouzah qui protège, et les liens intimes de la communauté juive ; de l’autre, les messes en latin du rituel catholique romain et Jesus sur la croix, puissance d’incarnation fascinant l’enfant, qui ne cesse de regarder Jesus dans les églises. La liturgie juive, qui est d’abord familiale, sera impuissante à conjurer le pouvoir du rituel romain sur cet enfant de six ans.
De cette victoire apparente du catholicisme, le Pape Pie IX tire la vanité de croire que c’est un triomphe, plus que de la prééminence du droit canonique, de l’Esprit saint qui aurait choisi l’enfant par l’intermédiaire d’une servante. Mais Bellocchio montre combien est vaine et trompeuse la victoire de ce Pape capricieux et instable, par moment ridicule : il ne peut arrêter la lente défaite du pouvoir temporel romain, et tout ce qui résultera de son rapt, c’est de faire d’Edgardo un homme perpétuellement insatisfait, ne pouvant accepter que sa mère demeure juive. Surtout, il fait voir, en filmant toujours Edgardo de l’extérieur, qu’il est impossible de sonder son coeur, qu’il est impossible de savoir comment procède cet accaparement d’un être par un dogme, qu’il s’agisse comme ici du dogme catholique ou, pour son propre frère, du dogme marxiste. On ne peut que décrire de l’extérieur l’empoisonnement de l’esprit de l’enfant par le lent endoctrinement des prêtres et l’atmosphère des monastères. Nul esprit qui vaille dans ce travail de sape sur le cerveau d’un être faible séparé de sa famille. De ce point de vue, le jeune acteur qui joue Edgardo enfant possède le visage adéquat, un visage d’ange muet qui attend, page blanche sur laquelle le Pape IX écrira sans vergogne son avenir en se faisant mère et père de substitution (même plan de l’enfant dans ses jupes, comme celles de sa mère). Le mystère de cet enfant qui ne peut dire non, c’est celui de tous les enfants, tous les êtres, sacrifiés sur l’autel du dogme, le dogme qui interdit toute remise en question, tout questionnement, et qui par la même est le pire ennemi de la vérité et des hommes.
Strum