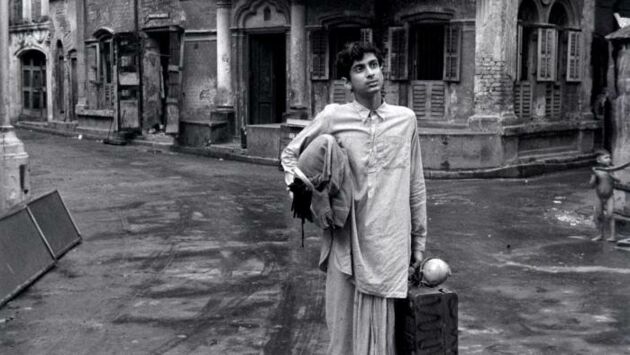Quatre ans avant L’Homme qui tua Liberty Valance, huit ans avant Frontière chinoise, La Dernière Fanfare (The Last Hurrah) (1958) est déjà pour John Ford un testament, qui va ouvrir la dernière partie de son oeuvre. En racontant l’ultime campagne électorale d’un vieux maire irlandais d’une ville de la Nouvelle Angleterre que l’on reconnait comme Boston, Ford rend compte de la disparition d’un monde : le sien. Il le fait sans dissimuler ses insuffisances, ses arrangements avec la vérité, mais les aperçus qu’il montre du nouveau monde qui va lui succéder font craindre le pire.
Ford, comme à son accoutumée, aborde dans ce film remarquable des sujets constitutifs de la société américaine, à partir de la vie et du sort de ses personnages. Son héros Frank Skeffington (inspiré du véritable ancien maire de Boston, James Michael Curley, qui intenta d’ailleurs un procès à la production pour atteinte à la vie privée) est représentatif des minorités immigrées venues aux Etats-Unis par vagues successives. Il a conscience de ses origines sociales et possède la fierté d’avoir réussi, lui le fils d’une domestique. Il en éprouve le désir d’aider, avec les moyens que le destin lui a confiés, les plus démunis ainsi que les minorités de la société américaine. En organisant une confrontation entre, d’un côté, les instincts les moins avouables de l’identité américaine, tels qu’ils peuvent s’exprimer à travers les personnages d’Amos Force, un patron de presse ancien membre du Klu Klux Klan (John Carradine, un fidèle de Ford) et Norman Cass Sr. (Basile Rathbone) banquier protestant hautain dont on peut présumer qu’il pense, conformément à l’analyse de Max Weber sur « l’éthique protestante », que les pauvres le sont en raison d’une prédestination liée à leur inactivité et, de l’autre, un irlandais fils d’immigrés s’étant frayé un chemin tout en haut de la société américaine, Ford fait voir combien les conflits entre communautés irriguent la société américaine, hier comme aujourd’hui. De ce point de vue, le vivre-ensemble américain qui repose sur un système de compromis et d’équilibres économiques et sociaux entre des communautés reconnaissant leurs particularités est fort différent du modèle d’intégration français où il est demandé au nouvel arrivant de se défaire de ses origines pour revêtir la citoyenneté française, la cohésion nationale étant assurée essentiellement par l’Etat.
Une scène du film éclaire la nature de ce conflit entre communautés, celle où Skellington s’introduit, sans y être invité, dans le saint des saints du pouvoir WASP (White Anglo-Saxon Protestant) de la ville, un club où sont réunis, à l’occasion d’un déjeuner d’affaires, patrons de presse, représentants religieux et banquiers. Skellington est furieux car un pool bancaire a refusé à la municipalité un prêt sur lequel elle comptait pour financer la construction de logements sociaux en raison de la notation financière insuffisante de la ville. Son éclat est celui d’un maire défendant ses administrés mais plus encore celui d’un homme blessé, qui n’a jamais digéré l’humiliation subie par sa mère lorsque, encore domestique, elle fut renvoyée pour le vol de deux bananes et une pomme de la demeure du père d’Amos Force. Cette blessure est encore ouverte, elle explique encore pourquoi il n’abandonne jamais. Or, l’identification de Ford avec son héros est trop patente pour ne pas poser comme hypothèse que le réalisateur devait avoir vis-à-vis de la culture américaine majoritairement protestante les mêmes préventions, devait éprouver dans son être la même blessure que celle de son personnage. N’a-t-il pas un jour déclaré qu’il ne s’était enfin senti vraiment américain, lui le fils d’immigrés irlandais, que lorsque J.F. Kennedy, lui-même issu d’une famille irlandaise, avait été élu Président ? Les ressentiments de cet ordre, qui plongent leurs racines dans l’enfance et l’histoire d’une famille, ne s’éteignent peut-être jamais. Si cette observation est juste, alors elle pourrait expliquer pourquoi Ford, dans la dernière partie de sa carrière, n’a cessé de se rapprocher des minorités américaines (les indiens, les noirs) et de les défendre, tout comme Skellington lui-même.
Une des caractéristiques du génie de Ford est que ces observations sur la société américaine s’inscrivent dans des récits portés par des personnages entièrement réalisés, très bien écrits (ici par Frank Nugent, scénariste récurrent de Ford), qui communiquent leur vitalité, leur chaleur, aux cadres du réalisateurs. C’est le cas de Skellington, joué par un formidable Spencer Tracy. Ford raconte par son entremise l’importance des relations individuelles, qu’il s’agisse de la manière dont Skellington se souvient chaque matin de sa femme décédée en déposant une rose dans un vase, ou de ses fidélités en amitié qui l’amènent à conserver dans son équipe de campagne un homme comme Ditto (Edward Brophy), dépourvu de tout espèce de compétences. Ford, à l’instar de sa caméra qu’il a souvent maniée selon un angle de contre-plongée, part de l’humain pour regarder le reste de la société, à partir du bas, en se plaçant au niveau des individus, sans lesquels une communauté n’existerait pas. A cet égard, la scène de la veillée funèbre de Minihan est exemplaire. Il s’agit d’une vieille connaissance du maire, qui a perdu ses amis à force de pingrerie et de comportement peu amène. Lorsque Skellington arrive au début de la veillée funèbre, une seule personne est présente, une vieille commère habituée de l’exercice (Jane Darnell, qui semble incarner sa propre caricature). La nouvelle de la venue du maire se répand et arrivent alors plusieurs représentants de la communauté irlandaise du district, qui reconstituent autour de lui l’idée d’une communauté pouvant soutenir la veuve de Minihan dans l’épreuve qu’elle travers. Ce que le neveu de Skellington, le journaliste Adam Caufield (Jeffrey Hunter), prend pour un meeting électoral se déroule en fait au niveau plus profond des relations humaines fondatrices d’un groupe, la politique n’étant finalement qu’une forme dégradée, plus vulgaire et moins fiable, de ces relations, car reposant sur des stratégies construites en vue d’une victoire. La veillée funèbre est comme le renouvellement implicite de ce pacte reliant les membres de la communauté irlandaise, magnifiée par les compositions de plan de Ford, qui intègrent tant de personnages à la fois dans l’image : entre autres dons, il avait reçu celui de filmer les groupes. La veuve confortée croira à tort que son mari avait beaucoup d’amis ; l’idée que la société a parfois besoin de légendes, ou d’exagérations, est une constante chez Ford (du Massacre de Fort Apache à L’Homme qui tua Liberty Valance)
La grande empathie que révèle le regard du cinéaste sur Skellington ne l’empêche pas de montrer un côté moins reluisant de ce personnage à la fois digne et truculent : sa propension à recourir au chantage pour parvenir à ses fins. La manière dont il piège le fils benêt de Cass Sr. en le nommant chef des pompiers de la ville alors qu’il sait pertinemment qu’il serait incapable de répondre aux besoins de cette charge témoigne chez lui d’une absence de scrupules et d’une morale à géométrie variable. On pourrait arguer pour le défendre qu’il agit dans le but noble de construire des logements sociaux, selon une perspective téléologique rachetant ce procédé douteux. Mais il n’est pas vrai que de telles vilénies s’en trouvent lavées de tout opprobre. Le héros fordien, et en particulier le Lincoln de Vers sa destinée, a souvent eu recours à des arrangements avec la morale et les principes, mais il n’a jamais versé dans un chantage du type exercé par Skellington. Or, c’est précisément ce chantage qui va pousser le banquier Cass Sr. à se décider à financer sans limitation de montants la campagne électorale de l’adversaire de Skellington. Ce chantage est peut-être indirectement à l’origine de la défaite de Skellington, comme si le don de double vue de Ford, qui me parait être une manière plus juste de définir sa manière que d’évoquer simplement ses « contradictions », lui avait fait pressentir que Skellington allait cette fois trop loin. Bien qu’il éprouve beaucoup de tendresse pour cet alter ego, Ford, qui voit l’envers des actions, ne l’approuve donc sans doute pas en tout (quoiqu’il ne soit pas allé jusqu’à montrer les actes de corruption dont le véritable maire s’était rendu coupable, qui l’avaient conduit à la prison dans la réalité). Le monde ancien tel que décrit par Ford n’a jamais été un monde idéal, où que le regard porte. On n’y trouve pas que des « Hourrahs ».
Parmi toutes les observations que le film porte à notre attention, la plus désarçonnante, la plus pessimiste, la plus triste, est la sévérité du jugement de Ford sur les jeunes gens de l’histoire. Certes, Adam Caufield, neveu de Skellington, est un héritier putatif possible, mais c’est un journaliste, un observateur, pas un acteur de l’histoire. Et si l’on tient Skellington, Cass Sr. et Amos Force pour les figures les plus significatives du récit, alors cela signifie que la nouvelle génération n’est pas à la hauteur du monde : Skellington et Cass Sr. ont chacun un fils unique d’une bétise insigne, inconscient de son environnement, incapable du moindre geste utile, tandis que Force est sans enfants. Les rapports entre Skellington et son fils révèlent l’incapacité dans laquelle le père se trouve de comprendre son fils. A chacune de leur rencontre, il reste muet tandis que l’autre ne pense qu’à s’amuser et parle sans comprendre son insignifiance ni réaliser que son père est consterné. C’est une vision très sombre, non seulement de la suite de l’histoire des Etats-Unis, mais aussi de la filiation. On sait que Ford fut déçu par son fils Pat. Il serait trop schématique de vouloir à tout prix voir ici un décalque de celui-ci dans le personnage de Frank mais si Ford y a pensé, quel terrible désaveu pour son propre fils !
Le monde qui vient avec ses fils incapables est aussi celui de la télévision. Lors de la scène du film où l’adversaire de Skellington, McKluskey, lui aussi de la nouvelle génération, donne une inteview dans son propre domicile, Ford s’inspire d’une intervention célèbre de Nixon à la télévision américaine en 1952 (le « Checker’s speech ») où, pour donner le change face à une accusation de corruption, il eut l’idée de se faire filmer chez lui en famille avec son chien. Dans cette scène du film, c’est le chien loué pour l’occasion par les communicants de McKluskey qui devient le protagoniste principal de l’interview télévisuelle, les électeurs étant en fait appelés à voter pour une image, une représentation fausse d’une famille américaine idéale. Scène très drôle (le film en comporte plusieurs malgré sa nature crépusculaire), qui signifie néanmoins que le nouveau monde tel que Ford le dépeint est celui où les élections se décideront en fonction du nombre d’affiches et de spots publicitaires diffusés, autant dire en fonction du montant consacré au financement de la campagne électorale concernée, qui brasse des sommes considérables aux Etats-Unis, où le financement public est désormais marginal et les dons des entreprises illimités dans les faits. Mais ni Skellington, ni Ford ne seront là pour le voir. Dans Le Soleil brille pour tout le monde (1953), le film préféré de Ford parmi ceux qu’il a réalisés, qui raconte aussi une campagne électorale, les tensions entre les communautés sont apaisées par le Juge Priest, qui obtient d’une voix, la sienne, sa réelection. Dans La Dernière Fanfare, vient pour Skellington le crépuscule, tandis que ses fidèles deviennent des ombres montant dans la peine un escalier (superbe plan expressionniste qui fait comprendre qu’eux aussi n’appartiennent pas au monde qui vient, doivent quitter la scène). L’ancien temps du Judge Priest a disparu où l’on pouvait gagner d’une voix aux Etats-Unis au nom des coutumes du pays. Aujourd’hui est le temps de Facebook, Twitter, de l’élection acquise par Donald Trump à coup de millions de spots et d’annonces sur internet, des recomptages de voix. De ce point de vue, on peut voir dans La Dernière Fanfare, un grand Ford, une manière d’avertissement.
Strum