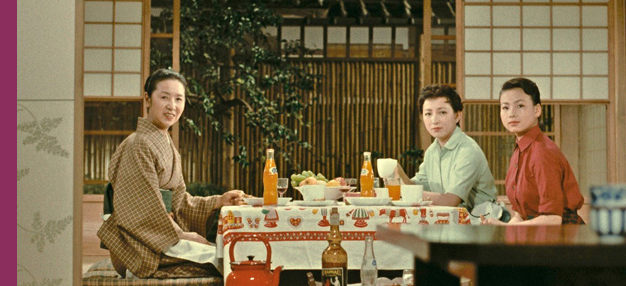Les choses qu’on dit, les choses qu’on fait (2020) d’Emmanuel Mouret, est bâti comme un roman du XVIIIe siècle, plus encore que Mademoiselle de Joncquières qui adaptait pourtant un des récits de Jacques le Fataliste de Diderot. On y trouve deux narrateurs principaux, Maxime (Niels Schneider) et Daphné (Camélia Jordana), que le hasard a réuni et qui se racontent l’histoire de leurs amours, comme en un échange de sentiments, lequel échange modifie en retour la nature de leurs rapports au point de cristalliser en eux un sentiment amoureux réciproque, comme si les mots pouvaient générer des sentiments amoureux, comme si l’intimité que révèle tout récit, ouvrait le chemin de leurs coeurs. C’est que Maxime et Daphné ont tous deux subi une peine d’amour. Depuis des mois, des années peut-être, Maxime aime Sandra (Jenna Thiam), mais s’avère incapable de tirer de cet amour l’ingéniosité devant présider au jeu de la séduction, pétrifié par cette femme au regard de Méduse. Pire, lorsque Sandra lui fait l’étrange proposition de venir vivre avec elle et son compagnon Gaspard, Maxime accepte, ne pouvant refuser quoique ce soit à la jeune femme. Quant à Daphné, si elle attend aujourd’hui un enfant de François (Vincent Macaigne), le cousin de Maxime, peut-être ne s’est-elle pas encore tout à fait remise du chagrin d’amour que lui a causé un documentariste dont elle s’était épris et qui lui a préféré une de ses amies.
Le titre du film annonce donc de manière littérale la pente du récit. Les mots ne sont ici ni masques, ni mensonges (on ne se trouve pas chez Lacan), ils ont un pouvoir actif, ils produisent des récits, des sentiments, des conduites, ils font coulisser un volet sur une nouvelle réalité. Les histoires de Maxime et Daphné vont déclencher chez l’autre un désir trouvant son origine dans la seule écoute du récit. Lorsque Daphné cite la célèbre formule hégélienne relative au désir (« le désir est le désir du désir de l’autre »), y compris sa déclinaison selon laquelle on devient un autre à travers le désir, elle annonce ce qui va se passer, conformément au concept du désir mimétique que René Girard conçut dans le prolongement de Hegel en l’appliquant à la situation d’un triangle amoureux. Les séquences du film se déroulant au cinéma où les personnages regardent Les Onze Fioretti de François d’Assise de Rossellini ou Cary Grant à l’écran et en reçoivent un afflux de sentiments expriment cette même idée d’un sentiment naissant par le jeu du mimétisme du récit d’un autre.
On peut regretter, cependant, que le film applique de manière assez mécanique, assez illustrative, le concept du désir mimétique, passant de la théorie à la pratique immédiatement après la fin des récits de Maxime et Daphné enchâssés dans le récit principal. Le lendemain de leur rencontre, ils semblent déjà amoureux, sentiment que Mouret fait voir par des plans de regards retenus par l’un et l’autre. Cette naissance du désir amoureux apparait dès lors un peu trop rapide, dépourvue des étapes du discours amoureux que l’on voit si bien chez Rohmer par exemple, une des influences de Mouret pourtant. A cette aune, le film ne répond pas tout à fait aux promesses qu’il a fait naître faute d’inspirations formelles, que ne peut compenser la série d’amours inconstants dévoilée par l’enchâssement des différents récits. L’alliage entre les mots et les images, la théorie et la pratique, était plus convaincant dans Mademoiselle de Joncquières où le discours sur l’harmonie commune entre l’amour et la nature trouvait sa forme dans le récit. L’utilisation systématique de standards de la musique classique (Chopin, Debussy, Satie, Mozart, jusqu’à l’adagio de Barber qui sonnait la fin de l’Elephant Man de Lynch et dont le pathétique s’accorde mal à la scène du départ de Maxime, qui ne connaît Daphné que depuis deux jours) est de la même eau : elle déçoit par son caractère trop attendu, trop répétitif. C’est comme s’il manquait au film sur le plan cinématographique cette inspiration magique, cette fantaisie inexprimable et imprévisible que l’on trouve chez Lubitsch, autre maître de Mouret, et en particulier dans Sérénade à trois, film profond sous une drôlerie de tous les instants où l’on trouve un ménage à trois, à l’instar de celui que constituent Maxime, Sandrine et Gaspard. Lubitsch était profond sans que l’on s’en aperçoive, sans devoir passer par les fourches caudines de la théorie. Contrairement à une idée reçue, notamment dans la critique française, où l’on pratique souvent les catégorisations entres les genres, les distinctions entre le haut et le bas, le burlesque et l’esprit ne sont pas les ennemis de la profondeur.
Ces réserves faites, le film intéresse par autre chose que l’application de la théorie du désir mimétique. Un trait de caractère commun relie en effet plusieurs personnages : le goût de l’effacement. Maxime s’efface devant Gaspard ; Daphné s’efface devant son amie étudiante ; Louise (Emilie Dequenne), surtout, l’épouse de François, s’efface devant Daphné. C’est cette récurrence de la figure de l’effacement qui finit par intriguer, qui va de pair d’ailleurs, avec l’idée que ces amours fugaces et inconstants ne trouvent jamais une juste rétribution, chaque personnage paraissant toujours déchiré entre plusieurs élans, plusieurs souvenirs, qui contrarient le présent. L’amour apparait alors comme une promesse jamais tenue, relevant presque du jeu des apparences, voire du simulacre comme dans cette scène où Louise simule un bonheur retrouvé avec un autre pour cacher son malheur aux yeux de François, et qui est rétrospectivement la plus belle du film. Un paradoxe car Louise est le seul personnage du récit dont l’amour est constant. Cette difficulté à aimer véritablement la compagne ou le compagnon était d’ailleurs une des leçons de La Recherche de Proust où Swann épouse Odette, une femme « qui n’est pas son genre ». Peut-être sont-ce justement les choses qu’on ne dit pas, les choses qu’on ne fait pas, à rebours de ce titre faussement littéral, qui sont les plus importantes pour Mouret : c’est ce qu’il ne montre pas, ne dit pas explicitement, qui compte. Derrière les sourires de circonstances, persistent les regrets, et c’est sans doute là que réside la vérité de ce film imparfait, où l’exécution n’est pas à la hauteur des intentions, mais néanmoins attachant.
Strum